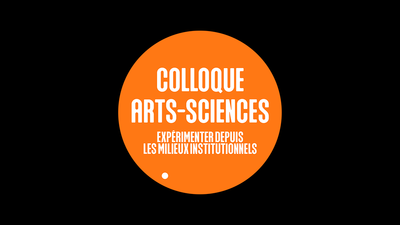Colloque : Expérimenter en arts-siences
milieux, institutions, pédagogie
La Scène de recherche a le plaisir d’accueillir un colloque organisé par Audrey Gosset, normalienne agrégée et attachée temporaire d’enseignement et de recherche à l’ENS Paris-Saclay. Pour la mise en place de cette journée, elle est accompagnée de Victor Thimonier (Maître de conférence en études théâtrales à l’Université d’Évry - Paris-Saclay et artiste associé à la Scène de recherche) et Morgan Chabanon (Maître de conférence à CentraleSupélec).
Ce temps fort rassemble chercheur·euses, artistes et scientifiques pour repenser la relation entre arts et sciences. Trop souvent enfermés dans des oppositions figées, ces domaines sont ici envisagés dans leurs collaborations fécondes, mais aussi dans leurs zones d’incertitude, tensions et doutes. Ensemble, ils partagent récits, outils et gestes, pour mieux comprendre comment ces deux mondes s’enrichissent mutuellement.
Lundi 13 octobre - Reconfigurer les régimes de vérité au théâtre : savoirs et institutions (9h30-21h)
- 09h30 Accueil café – Espace Simondon
- 10h00 Mot de bienvenue — Ulysse Baratin – Scène de Recherche
- 10h15 – 12h30 Conférence Performée — Chloé Déchery & Marion Boudier – Scène de Recherche
Cartes du retour — Chloé Déchery & Marion Boudier - 12h30 – 13h00 Décrire en jouant : praxéographie, ethnodramaturgie et théâtre des situations — Bernard Müller
- 12h30 Déjeuner
- 14h00 – 14h30 « le peuple ne vous demande pas de travailler avec le Collège de France » – Victor Thimonier
- 14h30 – 16h00 Rencontre autour du Petit bréviaire tragique à l'usage des nimaux humains du XXIème siècle, création de la cie Tf2 Jean-François Peyret — Maëlla Mickaëlle
- 16h00 – 16h15 Pause
- 16h15 – 16h45 Expérimentations sonores pour le théâtre – Paul Goutmann
- 17h30 – 18h15 Arts et Sciences - Des figures d’un rapport — Christian Ruby
- 18h15 Buffet
- 19h45-21h00 Projection Cherche toujours (film d’Étienne Chaillou et Mathias Théry)
Mardi 14 octobre - Expérimenter et transmettre : pédagogies situées et écologie du savoir (9h30-19h30)
- 09h30 – 10h00 Accueil café – Espace Simondon
- 10h00 – 11h00 Diffusion sonore : Paroles Ecotones – Scène de Recherche
- 11h00 – 13h00 Atelier participatif : Thermodanse
- 13h00 – 14h30 Déjeuner
- 14h30 – 15h00 Investigation-Publication: les défis de la recherche-création selon Vilém Flusser — Yves Citton
- 15h00 – 16h00 Filmer en laboratoire — Mathias Théry
- 16h00 – 16h15 Pause
- 16h30 – 18h30 Table ronde : Repenser la transmission
Gaël Latour & Constantin Jopeck
Cécile Bouton / Anne Broise
Morgan Chabanon
Simona Ferrar & Simon Henein - 18h30 – 19h00 Défis pédagogiques et épistémologiques dans les pratiques art-science - Ivan Magrin-Chagnolleau
- 19h00 Conférence de clôture
- À partir de 19h30 Buffet
Ce colloque bénéficie d'un financement par la Maison des Sciences sociales et des Humanités Paris-Saclay.
Ce colloque bénéficie d'un financement par la Maison des Sciences sociales et des Humanités Paris-Saclay.
Programme détaillé
Chloé Déchery & Marion Boudier
Titre : Conférence performée : Créer sous d’autres noms que le sien suivi du Jeu des Cartes du Retour
Biographies : Née en 1980, Marion Boudier est dramaturge et enseignante-chercheuse en arts du spectacle. Passionnée par les processus de création et le travail en équipe, elle a construit son parcours en faisant en sorte que ses trois activités de dramaturge, chercheuse et enseignante se nourrissent mutuellement et fonctionnent en synergie au service d’un plus grand nombre. Depuis plus de 20 ans, elle intervient auprès de publics divers et dans des contextes variés, au sein de lieux de création, dans des écoles d’art, pour des ateliers, des rencontres ou des conférences.
Après des études de lettres modernes et une thèse consacrée à la représentation du réel dans les dramaturgies contemporaines, Marion Boudier développe une pratique de dramaturgie prospective et documentaire au sein de la Compagnie Louis Brouillard pour accompagner l’écriture de plateau. Dramaturge des spectacles de Joël Pommerat depuis 2013, elle est également chargée de l’établissement des textes et de leur suivi éditorial pour Actes Sud, de la réalisation de dossiers pédagogiques, de rencontres avec les publics et de travaux rédactionnels pour des documents de production et de communication.
Elle collabore aussi avec l’actrice et réalisatrice Eve-Chems de Brouwer, avec le conteur Gérard Potier et avec l’auteur-metteur en scène Guillermo Pisani. Selon les projets, elle développe des collaborations avec des chercheurs d’autres disciplines, notamment en sciences sociales mais aussi en géophysique ou en robotique. Depuis 2022, elle est chercheuse associée au Laboratoire d'Histoire Permanente du Centre Pompidou et collabore avec des chorégraphes autour de la question de l’archive (Carolyn Carlson, Bintou Dembélé). En 2023-24, elle est en résidence de recherche au Studio Théâtre de Vitry pour mettre en place des laboratoires de création autour des usages de la documentation par les interprètes (projet ADOC).
Également Maîtresse de conférences à l’Université Picardie Jules Verne (Amiens) et membre de l’Institut Universitaire de France, elle a assuré la direction du Département des Arts du Spectacle (2019-21), prenant en charge le recrutement des artistes intervenant·es et la mise en place des conventions avec les partenaires du territoire. À ces expériences de co-création, de collaboration institutionnelle et de gestion d’équipe, s’ajoute celle du portage de projet en binôme avec Chloé Déchery depuis 2018 pour le programme de recherche et de création Performer Les Savoirs. Grâce au soutien de nombreux partenaires académiques et culturels, elles organisent des journées- laboratoires, des séminaires et des workshops en invitant des artistes et chercheur·es-artistes et en passant des commandes pour des créations. Leurs travaux contribuent à la diffusion des Performance studies et des nouvelles pratiques artistiques de recherche en France.
Chloé Déchery est artiste de performance et chercheuse en performance studies. Son travail de création fait la part belle à l’expérimentation, au processuel et à une dynamique collaborative et emprunte, selon les projets et leurs nécessités internes, à des formes performatives ou chorégraphiques pour se placer à la jonction entre recherche autobiographique, enquête documentaire et élaboration fictionnelle. Son travail porte notamment sur les questions de langage et de communicabilité, de mémoire et de construction identitaire, et sur les relations diplomatiques entre vivants.
Interprète de formation, Chloé Déchery a travaillé en France, en Australie et en Grande- Bretagne - où elle a vécu 10 ans - avec des chorégraphes et des metteur.euses en scène comme Ivana Müller, Olivier Normand, Cristèle Alves Meira, Anne Bean, Sheila Ghelani, Rajni Shah, Improbable, Luke Dixon, The Fondue Set, Jane McKernan ou Emma Saunders. Depuis 2009, elle est l’autrice de formes performatives qui se développent au croisement entre Live Art, chorégraphie et performance autobiographique. Parmi ses pièces les plus récentes, on compte Bardane et moi, partition pour femme de 40 ans et plante sauvage créée en 2022 ou On The Horizon, une pièce chorégraphique créée en 2017, conçue pour l’espace public et qui s’écoute au casque. Son travail, porté par l’association moustache, créée en 2009, est soutenu par le Arts Council England, le British Arts Council, Eur ArTeC ou l’Institut français.
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure-Lettres et Sciences Humaines à Lyon et agrégée de lettres modernes, Chloé Déchery est également théoricienne et maîtresse de conférences en études du théâtre et de la performance à l’université de Paris 8. Titulaire d’un doctorat en esthétique et arts du spectacle dédié aux pratiques corporelles dans la performance contemporaine, Chloé Déchery a enseigné la théorie et la pratique de la performance en France (Ecole Normale Supérieure-Ulm, Université de Paris Nanterre, Institut des Sciences Politiques de Lille), en Grande- Bretagne (University of Surrey, Queen Mary University, Goldsmith University, Royal Central School of Speech and Drama) et en Australie (University of Wollongong).
À partir de cette triple entrée ; artiste, théoricienne, pédagogue, Chloé Déchery s’intéresse de près aux logiques d’hybridation entre expérimentation pratique, innovation artistique et élaboration théorique. Ce faisant, elle propose et anime régulièrement des temps de recherche et d’expérimentation artistique qui revêtent différentes formes : performance, workshop, lecture publique, laboratoire, conférence performée, écrit théorique ou performé.
Chloé Déchery est co-directrice artistique, avec Marion Boudier, de Performer Les Savoirs, plateforme curatoriale et programme de recherche artistique créée en 2018.
Résumé :
I. Créer sous d’autres noms que le sien est une conférence performée qui aborde les pratiques d'écriture féminine invisibilisées ou cachées, dont l’hétéronymie qui consiste à écrire « sous un autre nom que le sien ».
Munie d’un ensemble de lettres issues de la correspondance de sa grand-mère,et qu’elle a retrouvées dans les placards d’une salle de bain rose, Chloé partage les fruits d’une investigation qui la mène d'une maison de famille picarde à Douala, au Cameroun, en passant par un fonds d'archives à Vanves.
On tâche d'y faire la part des choses entre usurpation de manuscrits plus ou moins consentie et désir d'écrire refoulé. À mi-chemin entre la conférence, l’enquête et l’exercice du portait, la performance propose d'examiner ce que l’hétéronymie, quand elle est pratiquée par des autrices, dit du désir de prendre la parole, que l'on soit mère en 1951 ou chercheuse dans les années 2020.
La performeuse et chercheuse Chloé Déchery adopte sur scène un dispositif d'enquête qui comprend une caméra zénithale, des objets présentés à la table (lettres, livres, albums de photographies, foulards et nappes) et des films d'archive. Ce faisant, elle ouvre la boîte d'un intime familial comme on ouvrirait une boîte de Pandore pour révéler la dynamique compliquée qui se noue entre le caché et le montré, entre le désir d'écrire et le désir de dire « je » dans la société patriarcale et coloniale de la France des années 1950.
II. En guise de bord plateau, Marion Boudier et Chloé Déchery proposent d'échanger avec le public autour des enjeux de la conférence-performée Créer sous d'autres noms que le sien, à partir du Jeu des Cartes du Retour, un outil ludique qu'elles ont conçu et réalisé pour faciliter la prise de parole et la formulation de retours sur un spectacle en cours ou abouti.
Le jeu de carte, conçu en collaboration avec l'illustrateur Éric Valette, a pour ambition de contribuer au développement d'une « culture du retour » dans les milieux de la création, de la diffusion et de l'enseignement artistique. Comment parler de ce qu'on a vu, aimé ou pas compris, après un spectacle ou une présentation de maquette ? Quelles méthodologies développer pour que le dialogue autour du retour entre artistes, compagnies, responsables de lieu, programmateurices, spectateurices ne soit pas une contrainte mais une ressource pour le travail et les conditions de travail ?
Le Jeu des Cartes du Retour se veut dans la continuation du travail des deux chercheuses Chloé Déchery et Marion Boudier, dont l'ouvrage Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes – Performer les savoirs, paru en septembre 2022 dans la collection ArTeC, fait partie.
« Un ovni éditorial qui utilise intelligemment la gamification pour servir un propos artistique. » Mathias Daval, IO Gazette
Bernard Müller
Titre : Décrire en jouant : praxéographie, ethnodramaturgie et théâtre des situation
Biographie : Bernard Müller est anthropologue. Il explore les constructions narratives populaires contemporaines — discours historiques, mythes, rumeurs, fictions ou utopies — à travers une démarche croisant ethnographie, études théâtrales, ethnoscénologie et performance studies. Ses recherches, initiées en 1995 auprès d’une troupe de théâtre yoruba au Nigeria, l’ont conduit à développer une méthode d’ethnodramaturgie où la scène devient outil d’enquête. Il a depuis travaillé au Nigeria, au Togo, au Brésil, en Allemagne et en France, menant aussi des recherches de provenance et une enquête mémorielle sur l’histoire coloniale des collections muséales. Membre du LAP (EHESS), il co-anime le séminaire « Objets et choses en sciences sociales » et, en 2025-2026, l’atelier « L’anthropologie à l’épreuve de la pluralité des formes d’écriture » (avec C. Pasqualino, A. Fiorentini, M. Lamotte et A. Bertina). Il participe à plusieurs comités éditoriaux, dont COMMUNICATIONS (n°116, Dramaturgies du réel, 2025), et coordonne l’association CURIO – Ouvroir d’anthropologie potentielle.
Résumé : Cette intervention explore les convergences entre dramaturgie et anthropologie praxéographique. Décrire ou rejouer une action revient à en saisir les règles implicites et la logique de situation. À partir de Bazin, Wittgenstein, Schechner et Goffman, il propose la notion de « dramaturgie du réel », où toute interaction sociale est rejouable mais toujours singulière. L’ethnodramaturgie désigne cette méthode qui transpose les didascalies sociales sur scène pour en tester les effets. La scène apparaît ainsi comme un véritable laboratoire d’enquête.
Victor Thimonier
Titre : « le peuple ne vous demande pas de travailler avec le Collège de France »
Biographie : Victor Thimonier est maître de conférences en études théâtrales à l’Université d’Evry Paris Saclay et membre du laboratoire SLAM, axe Recherche-création théâtre. il est également metteur en scène et directeur artistique de la Cie Les Temps Blancs (www.lestempsblancs.fr).
Résumé : Serait-on en droit d’attendre que le peuple demande aux pouvoirs publics la création de spectacles issus d’une conversation entre un artiste exigeant et un professeur du Collège de France ? À travers un parcours dans les créations de Jean-François Peyret et Alain Prochiantz, il s’agira de voir comment les interstices des institutions peuvent donner lieu à des formes scéniques singulières qui exigent d’autres attitudes de spectateur·rice·s.
Maëlla Mickaëlle
Titre : Rencontre autour du Petit bréviaire tragique à l'usage des nimaux humains du XXIème siècle, création de la cie Tf2 Jean-François Peyret
Biographie : Maëlla Mickaëlle est une artiste pluridisciplinaire qui œuvre entre danse et image. Cinéaste, autrice multimédia, vidéaste en arts vivants, danseuse et musicienne, elle est aussi co-fondatrice de Milla Studio. Elle collabore de longue date avec le metteur en scène Jean-François Peyret pour lequel elle crée des vidéos, et avec la plasticienne Agnès de Cayeux en tant que danseuse. Maëlla Mickaëlle a réalisé plusieurs courts métrages, dont « Triple boucle » en 2020 sur le sujet des abus dans le domaine du sport.
Résumé : Maëlla Mickaëlle présentera des images issues de son processus de travail en laboratoire et sur le plateau de théâtre au sein de la cie Tf2 de Jean-François Peyret. Ces matériaux seront l’occasion de revenir sur le processus de composition en art-science et les problématiques institutionnelles rencontrées dans la réalisation du dernier spectacle de la compagnie. Elle discutera également avec Victor Thimonier de la place des techniciennes, créateur·rices au sein d’une compagnie de théâtre ou dans un laboratoire.
Paul Goutmann
Titre : Expérimentations sonores pour le théâtre
Biographie : Paul Goutmann est un musicien, compositeur et chercheur français. Il a soutenu sa thèse en 2023: « Représentation opératoire pour le traitement spatial du son : une approche de la création musicale et logicielle » sous la co-direction d’A.Bonardi et d’A.Sèdes dans le cadre d'ArTEC. Ses recherches ont été accueillies au sein du Centre de recherche en Informatique et Création Musicale (CICM, Musidanse) et portent sur le traitement spatial du son et sur les interactions entre développement informatique et composition musicale. Ses réflexions sur la mise en espace du son se prolongent dans une pratique de la réalisation en informatique musicale, la captation sonore et la création pour le théâtre. Il a collaboré avec plusieurs metteurs en scène (L.Favret, S.Mirzai, A.Acerbis, V.Thimonier) et a été lauréat du dispositif Création en Cours des Ateliers Médicis. Dans le cadre du projet “Habiter (avec) Xenakis”, il a proposé en 2022 une mise en espace la pièce Voyage Absolu des Unari vers Andromède de I.Xenakis pour le planétarium de la Cité des Sciences (évènement Philharmonie de Paris) et pour le concert Xenakis Alive (Onassis Stegi Conservatoire national d’Athènes). Depuis 2023, il collabore en tant qu’artiste-chercheur, musicien électronique du duo QUID.
Christian Ruby
Titre : Arts et Sciences (A&S) Des figures d’un rapport
Biographie : Christian Ruby, philosophe, membre du comité de rédaction de Raison présente, de l’ADHC (association pour le développement de l’Histoire culturelle), de l’ATEP (association tunisienne d’esthétique et de poiétique), ainsi que de l’Observatoire de la liberté de création. Il vient de publier : La fécondité du vide, Paris, MkF Éditions, 2024. Site de référence : www.christianruby.net
Résumé : Portant sur les rapports potentiels et effectifs entre Arts et Sciences (A&S), le propos s’ancre sur deux écarts nécessaires : éviter de soumettre ce rapport à un universalisme abstrait selon lequel tout serait indifféremment identique, d’autant qu’on se place sous le regard d’un absolu ; refuser l’exotisme1 de l’un sur l’autre (dans les deux sens). La logique de ce graphe (A&S) est la tension positive dans un accueil réciproque, laquelle fonctionne déjà dans des pratiques, mais qui n’est pas totalement rendue intelligible du point de vue épistémologique, au vu du nombre de notions contradictoires qui prétendent rendre compte de la nécessité de s’exercer à penser une nouvelle dynamique des sciences par les arts et des arts par les sciences.
Mathias Théry
Titre : Discussion autour du documentaire Cherche toujours
Biographie : Mathias Théry est un réalisateur français, né le 9 mars 1980. Issu d’une formation artistique aux arts Décoratifs de Paris, il réalise depuis une vingtaine d’années des films qui explorent le réel dans différentes formes de narration. Il est notamment connu pour avoir coréalisé avec Étienne Chaillou les documentaires La Sociologue et l'Ourson (2016) et La Cravate (2020).
Yves Citton
Titre : Investigation-Publication: les défis de la recherche-création selon Vilém Flusser
Biographie : Yves Citton est professeur de littérature et media à l’université Paris 8 et membre de l’Institut Universitaire de France. Il a été jusqu’en 2021 directeur exécutif de l’EUR ArTeC (Arts, Technologies, numérique, médiations humaines et Création). Il co-dirige la revue Multitudes et a publié, entre autres, La Machine à Faire Gagner les Droites (2025), Politics of Curiosity (avec Enrico Campo, 2024), Générations Collapsonautes (avec Jacopo Rasmi, 2020), Médiarchie (2017), Pour une écologie de l’attention (2014). Ses articles sont en accès libre sur www.yvescitton.net.
Résumé : Cette intervention présentera quelques-uns des enseignements qu'on peut tirer en relisant comme des défis à nos conceptions et pratiques de la recherche-création les propositions faites par le philosophe et théoricien des media Vilém Flusser (1920-1991) dans quelques textes récemment republiés sous le titre Arts, Sciences, Technologies (Presses du réel, 2025).
Gaël Latour & Constantin Jopeck
Titre : Table ronde : Repenser la transmission - Inspirations Optique et Art : pratiquer et interpréter
Biographies : Gaël LATOUR est enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay et mène son activité de recherche au Laboratoire d’Optique et Biosciences (Ecole Polytechnique, Palaiseau). Il travaille sur le développement et l’utilisation de techniques de microscopie optique dans le domaine biomédical, mais aussi dans le domaine des sciences du patrimoine en appui à la conservation-restauration des objets patrimoniaux. En tant qu'enseignant, il essaie de faire un pont entre ses activités de recherche et ses enseignements. Il propose ainsi des enseignements en optique pour montrer l'application de l'optique en lien avec les œuvres, soit au niveau de l'apparence visuelle ou soit dans l'utilisation d'outils d'analyse pour réaliser un diagnostic sur les œuvres.
Constantin Jopeck est artiste, Le Fresnoy - studio national des arts contemporains.
Résumé : Cet enseignement, intitulé "Optique et Art", est l’occasion d’une rencontre et d’échanges entre un physicien, spécialiste en optique, et un artiste. Pour les étudiant·es, les objectifs sont d’avoir une pratique artistique hebdomadaire sans pré-requis, d’approfondir des notions de physique et d’être sensibilisé.es à une démarche art et science. En croisant l’expérience artistique et l’expérience scientifique, cet enseignement repose sur un binôme physicien-artiste qui conçoit l’enseignement de bout en bout afin de s’assurer de sa pertinence et de sa qualité sur les deux volets disciplinaires.
Cécile Bouton
Titre : Table ronde : Repenser la transmission - Et si le théâtre ou le pliage changeait notre façon d'apprendre à l'université !
Biographie : Biologiste et chercheuse au CNRS en transition vers les sciences de l’éducation, je conçois des dispositifs pédagogiques fondés sur l’intelligence collective et les questionne en vue de développer les compétences psycho-sociales des enseignant·es et des étudiant·es.
Résumé : Je souhaiterais vous présenter deux dispositifs pédagogiques basés sur le théâtre-forum, permettant aux étudiant·es et enseignant·es d’expérimenter l’écoute mutuelle et l’ouverture à l’altérité. Ces qualités sont essentielles à la collaboration et favorisent une relation de qualité enseignant·e/étudiant·e. La formation continue visait à améliorer cette relation, tandis que la formation initiale offrait aux étudiant·es un rôle de co-constructeurices d’espaces de réflexion collective sur des enjeux de sciences-société.
Anne Broise
Titre : Table ronde : Repenser la transmission - Et si le théâtre ou le pliage changeait notre façon d'apprendre à l'université !
Biographie : Anne Broise maitresse de conférences en mathématiques à l'université Paris Saclay, responsable du master MEEF formation des professeurs des collèges et lycées en mathématiques.
Résumé : Depuis maintenant 3 ans, un atelier de pratique artistique a été intégré dans la formation initiale des professeurs de mathématiques : pliage ou théâtre mathématique dans le cadre des UE « maths, art et culture » et « enrichir son enseignement ». Ces ateliers visent à améliorer l’écoute de l’interlocuteur et la prise en compte de ses besoins. Ils visent aussi à faire réfléchir sur les implicites dans les consignes, qu’elles soient matérielles ou conceptuelles. Ces ateliers obligent enfin les stagiaires à réfléchir à leur enseignement et à trouver d’autres chemins pour parler de certains concepts mathématiques avec leurs élèves. La compétence professionnelle que l’on cherche à enrichir lors de ces ateliers est la posture réflexive de l’enseignant.
Morgan Chabanon
Titre : Table ronde : Repenser la transmission
Biographie : Morgan Chabanon est maître de conférences à CentraleSupélec, Université Paris-Saclay. Ses thématiques de recherche concernent la physique des transferts en milieux poreux et biologiques. Il crée et porte depuis 2022 le projet Thermodanse, visant à développer des chorégraphies participatives qui engagent les participant·es au coeur de modélisations vivantes de concepts scientifiques avancés. Il est également référent science et société à CentraleSupélec.
Résumé : Nous aborderons l'émergences d’innovations pédagogiques dans les interstices ouverts par l’art dans les institutions scientifiques. Nous discuterons de la pertinence de mêler pratique artistique à l'enseignement scientifique, du rôle de ces initiatives pour la communauté, ainsi que le positionnement des institutions scientifiques vis à vis de ces projets art-science-pédagogie.
Simona Ferrar & Simon Henein
Titre : Table ronde : Repenser la transmission - Création collective, arts improvisés et ingénierie : initiatives de l’EPFL
Biographies : Simon Henein est professeur en Microtechnique à L’EPFL et directeur du Laboratoire de conception micromécanique et horlogère (INSTANT-LAB) depuis 2012. Depuis 2017, il enseigne en outre, dans le cadre du programme Sciences Humaines et Sociales (SHS) du Collège des Humanités, un séminaire de niveau Master intitulé « IMPROGINEERING – Création collective : arts improvisés et ingénierie » qui permet aux étudiantes et étudiants de s’initier aux pratiques d’improvisation en danse, théâtre et musique et de s’interroger sur les processus de création collective dans les domaines des sciences et des techniques. Il a conduit un projet de recherche intitulé « Les arts de la scène comme outil pédagogique dans l’enseignement tertiaire » (ASCOPET) en collaboration avec l’Institut de psychologie et d’éducation de l’Université de Neuchâtel. Co-affilié au Collège des Humanités de l’EPFL, il dirige depuis 2024 le Performance Lighthouse, plateforme pour la promotion de projets d'arts vivants menés par des étudiant·es de l’EPFL. Il dirige actuellement la compagnie de danse L’Âme-de-Fonds qu’il a fondée à Neuchâtel en 2013.
Formée en Lettres à l’Université de Genève, Simona Ferrar est artiste de performance, danseuse et dramaturge. Elle a fondé la compagnie The Fig Tree & The River en 2021, et rejoint régulièrement d’autres équipes artistiques en tant qu’interprète et dramaturge. Elle collabore depuis juin 2024 auprès du Prof. Simon Henein pour assurer la coordination du Performance Lighthouse et la conception des projets artistiques de la plateforme.
Résumé : Nous présenterons les projets IMPROGINEERING et DÆNCITY, tous deux conçus pour transmettre aux étudiant·es de l’EPFL des pratiques issues de l’improvisation, telle qu’elle est pratiquée dans les arts vivants. Entre ateliers, résidences artistiques, processus de réflexion, recherches académiques et performances publiques, les expériences vécues permettent de défendre, avec de plus en plus de clarté, la pertinence de faciliter l’accès à des pratiques artistiques dans le cursus d’une école polytechnique, tout en créant des ponts entre le campus et des lieux culturels de la cité.
Ivan Magrin-Chagnolleau
Titre : Défis pédagogiques et épistémologiques dans les pratiques art-science
Biographie : Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU est un artiste philosophe qui se consacre essentiellement à la recherche académique et à l'enseignement, ainsi qu'à la création artistique. Il est affilié à Chapman University en Californie. Ses centres d'intérêt sont : le processus créatif et sa dimension phénoménologique, l'art et la philosophie, l'intelligence artificielle et la créativité, l'art et la spiritualité, l'art et l'environnement, l'art et l’éthique.
ivanhereandnow.com | @ivanhereandnow
Résumé : Qu'est-ce qu'une pratique art-science ? Qu'est-ce que la création recherche ? Comment s'articulent art et science dans une pratique art-science ? Comment appliquer ce genre de pratiques à la question climatique et environnementale ? Un exemple : l'équipe Arts&Sciences de Labos1point5 et ses productions. Comment transférer ces approches dans le domaine pédagogique ? Un exemple : une expérience pédagogique à Chapman University, "How Art Can Help Us Save The Planet".
Les participant·es de l’atelier Sciences/Arts
Titre : Paroles Ecotones
Participant·es à l’atelier et co-créateurices : Raphaël Honigsberg (ENS Paris-Saclay), Mattheus Burkhard (Université Paris-Cité), Antoine Covolo (ENS-PSL), Tristan Gamot (Institut Polytechnique de Paris, Sorbonne-Université), Audrey Gosset (ENS PS), Pauline Gosset (Université de Tours), Emile Le Lièvre (ENS PS), Clément Morhain (CentraleSupélec).
Résumé : Cette intervention propose l’écoute d’un documentaire sonore, composé à partir d’entretiens menés avec des doctorant·es en sciences théorico-expérimentales à l’issue d’un atelier Arts/Sciences à la Scène de Recherche de l'ENS Paris-Saclay. Leurs paroles donnent à entendre doutes, tensions et questionnements sur leurs pratiques de la recherche. Plus qu’une restitution d'atelier, il s’agit d’ouvrir un espace réflexif sur la production des savoirs, en croisant les enjeux de genre, d’écologie et de conditions institutionnelles. Cette polyphonie devient ainsi un milieu vivant où s’expérimente une pratique scientifique plus située, relationnelle et sensible - un espace pour prendre soin de la recherche.